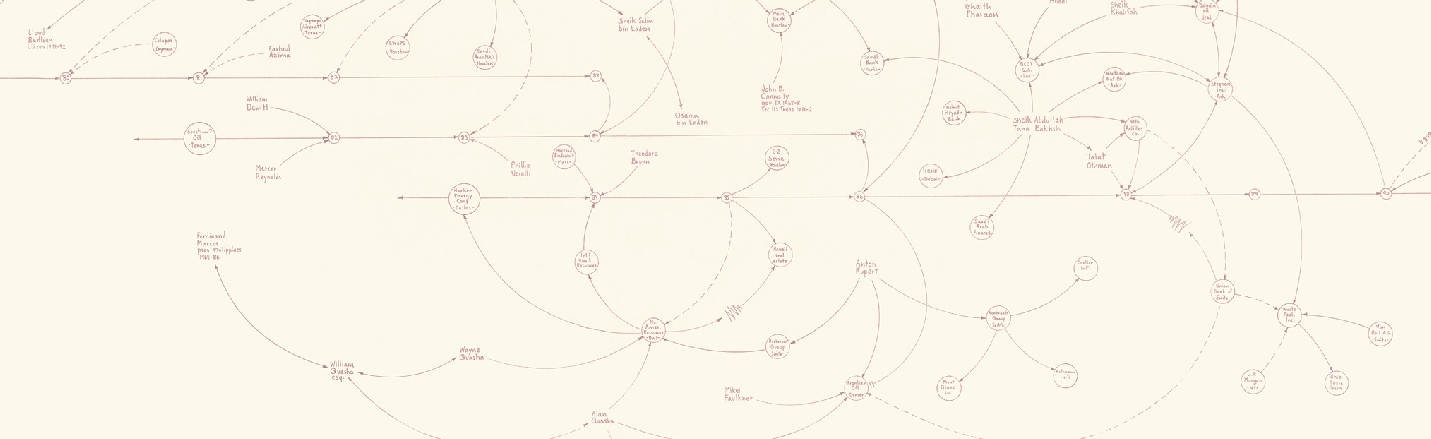APPEL À CONTRIBUTION
Logiques visuelles et nouvelles esthétiques de la protestation : réverbérations et confluences transnationales entre le zapatisme et l’altermondialisme (1994-2021)
Date limite de soumission des propositions : 7 décembre 2025
Langues : français, espagnol et anglais
Dates du colloque : Université de Grenoble Alpes, 22, 23 et 24 avril 2026
La chute du communisme et la fin de la Guerre froide, célébrées à grand renfort de discours par le « monde libre », semblaient consacrer deux slogans emblématiques de la fin des années 1980 : « la fin de l’histoire » et « il n’y a pas d’alternative ». Ces certitudes ont été toutefois rapidement ébranlées par l’émergence d’un mouvement social global de protestation, qui adopta bientôt le mot d’ordre « un autre monde est possible », en réaction aux excès du marché triomphant et aux ajustements structurels imposés par le Fonds monétaire international. Cette nouvelle coordination transnationale de mouvements sociaux contre la mondialisation capitaliste a reçu de nombreux noms : mouvement antimondialisation, altermondialiste, mouvement pour la justice globale ou mouvement des mouvements et se retrouvait également dans le slogan « Un autre monde est possible ».
Sa croissance rapide a confirmé qu’il existait une la résistance, comprise comme une nouvelle étape des processus d’émancipation (Plihon 2019), et le mouvement est devenu célèbre dans les médias grâce à l’organisation de « contre-sommets » : grandes actions collectives d’envergure transnationale qui avaient lieu en parallèle et en opposition aux sommets d’organisations transnationales telles que le FMI, l’Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale. Les contre-sommets activistes (comme Seattle en 1999, Prague en 2000 et Gênes en 2001), très exposés médiatiquement et très actifs, boycottaient les Sommets du Pouvoir et attiraient l’attention sur le rôle de gouvernement, d’entités non démocratiques et proposaient des alternatives. La médiatisation de ces mobilisations et leur résonance dans le monde de l’art contribuèrent à construire un nouveau régime visuel de la protestation et de l’organisation citoyenne.
Même si l’antimondialisation a marqué de son empreinte l’agenda du Nord global dans les années 1990 et au début du nouveau millénaire, c’est bien les montagnes du Chiapas au Mexique qui ont été son creuset. En janvier 1994, le soulèvement indigène zapatiste visait à répondre aux dynamiques néolibérales liées à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et envoyait un message clair à son pays. De plus, grâce à un usage expert des nouveaux moyens de communication, la force de ce message parvenait également aux militants internationaux. En revendiquant « un monde où tiendraient de nombreux mondes», le soulèvement zapatiste est devenu une référence de facto pour les activistes du monde entier et a inauguré un nouveau cycle de résistances et de mobilisation qui aura des conséquences directes en Europe.
En mêlant la lutte pour l’autodétermination des peuples autochtones et l’héritage internationaliste de la guérilla tricontinentale (dont il était issu via les Forces de libération nationale), le mouvement zapatisme a généré un espace de dialogue et de collaboration pour de multiples organisations militantes. La coordination transnationale des mouvements sociaux que l’on désignera comme « mouvement altermondialiste » est d’ailleurs née des Rencontres intergalactiques zapatistes (1996 et 1998), qui réunirent des activistes du monde entier au Chiapas. L’impulsion était donnée et d’autres mouvements d’organisation citoyenne et paysanne en Amérique latine (comme les Sans-terre au Brésil, la CONAIE en Équateur) sont apparus, qui ont contesté les politiques d’expropriation du capitalisme global (la guerre de l’eau en Bolivie en 2000, l’organisation des luttes en Argentine pendant le krach financier de 2001, la lutte étudiante au Chili en 2011) et ont été suivis (et assimilés) par la militance européenne.
Le dialogue entre luttes a permis que se développe une nouvelle mobilisation de la société civile en faveur d’un futur collectif et anticapitaliste, ainsi qu’une nouvelle esthétique de la résistance et de la protestation. Dans les temps déclarés de « l’empire et de la multitude» (Hardt et Negri 2004), la confluence entre le zapatisme et d’autres luttes du Sud global avec les mouvements sociaux occidentaux s’est accompagnée d’un renouveau des pratiques de collectivisation et de communalisation en Europe, qui, combinées à de nouveaux usages de l’image et de la performativité, cherchaient à concevoir des alternatives face aux excès néfastes de la mondialisation néolibérale.
À cela s’ajoutait la prise de conscience progressive de l’impact de la mondialisation néolibérale sur la planète de la part de nombreux groupes inquiets de la dégradation de l’environnement. Dans les pays du Sud, des manifestations ont été organisées contre l’internationalisation et l’intensification de l’extraction des matières premières vers les pays du Nord, dont l’économie était en pleine dérégulation. Parallèlement, et de manière institutionnelle, la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992) a été le signe que « des questions telles que le réchauffement climatique, les incendies en Amazonie, le changement climatique et la perte de la biodiversité » (Fioravanti, 2022) étaient désormais prises en compte. Cependant, face au peu de résultats obtenus, les protestations se sont amplifiées sous la forme d’un « processus politique » (Milani et Keraghel, 2007) assez inédit, le Forum social mondial, dont la première édition à Porto Alegre (Brésil, 2001) visait à défendre le « contrôle social sur l’environnement» (Milani et Keraghel, 2007). L’ensemble des questions débattues lors de ce premier FSM sont toujours d’actualité et sont réexaminées sous l’angle du bien commun.
Si les grands contre-sommets du mouvement antimondialisation ont perdu de leur force (pour un ensemble de raisons combinant répression et épuisement d’une forme de protestation spectaculaire), la persistance des mouvements contre le néolibéralisme global a continué à prendre des formes différentes (Agrikoliansky et al., 2005). Celles-ci se sont orientées vers des modèles plus décentralisés et coordonnés, intégrant également les réseaux sociaux, avec la multiplication conséquente d’images, de photographies, de vidéos et de mèmes. Ces dynamiques gardent un lien avec les projets d’autonomie et de souveraineté tels que le zapatisme, dont la pertinence s’explique par le fait que le zapatisme ne s’est pas limité à un geste de protestation ponctuel, mais s’est cristallisé en une pratique politique quotidienne de gouvernance communautaire, de défense du territoire et de construction d’alternatives économiques et culturelles. Dans ce sens, la construction de la société menée par les communautés zapatistes, ainsi que leurs principes et modes de vie, continuent à fonctionner comme un exemple de la possibilité d’établir un modèle de résistance et de coexistence valorisant les savoirs et l’identité indigènes, reconnaissant le rôle des femmes et attribuant une place à l’art dans ces processus.
Dans le cadre actuel d’un turbocapitalisme (Luttwak 2009) extractiviste, ces mouvements font face à un défi considérable avec les avancées de l’extrême droite qui, non seulement se double de l’émergence du concept d’« illustration obscure » (Land 2019), mais qui a également répliqué et coopté beaucoup de leurs modèles organisationnels et performatifs. Face à cette menace, et dans le but de tisser de nouveaux réseaux — en renonçant aux grandes manifestations spectaculaires de la fin des années 1990 et du début des années 2000 —, les zapatistes ont lancé en 2021 un « Appel pour la vie ». Celui-ci a constitué une invitation à la militance européenne à rejoindre un commun hybride et non binaire (Déclaration pour la vie 2021).
L’appel s’est accompagné d’une nouvelle prise de contact direct lors de la Travesía por la vida [Traversée pour la vie], réalisée par les zapatistes en Europe en 2021, afin de rencontrer les collectifs « de la base » luttant contre les lois écocidaires du marché et pour partager les expériences des activistes européens. Plus de 1 400 collectifs s’organisèrent pour les accueillir, partager des pratiques et des expériences, par le biais d’événements festifs et politiques, via un travail de communication intense (photographies, affiches, vidéos, réseaux sociaux). Après trois décennies durant lesquelles le Chiapas avait accueilli des milliers de personnes venues d’Europe pour apprendre d’un territoire marqué par des luttes atypiques et le partage des savoirs, c’était désormais au tour des militant·e·s européen·e·s de répondre politiquement et culturellement à la demande de dialogue et de connaissances partagées des zapatistes.
Si le zapatisme avait déjà transformé l’usage de l’image (Zagato et Arcos 2017), les collectifs européens ont su démontrer une créativité inédite dans la défense commune de la vie et contre le racisme, le sexisme et l’homophobie. En bouclant le cercle des premières Rencontres intergalactiques à Chiapas, les rencontres nées de la Travesía por la vida ont prolongé la formation d’un commun transnational connectant l’Amérique latine et ses luttes avec l’Europe des XXe et XXIe siècles, non seulement dans l’action directe, mais aussi dans la culture visuelle et performative.
Ce colloque se propose d’étudier le pouvoir des images et des pratiques performatives dans les mouvements sociaux latino-américains de résistance à la mondialisation, en explorant leur rôle dans une perspective transnationale et de dialogue en s’intéressant au zapatisme et aux luttes du Sud global. Si ces luttes ont été étudiées sous l’angle des combats pour la terre, l’autonomie et dans la continuité des grands mouvements insurrectionnels latino-américains (Baronet et al. 2011), nous proposons de les envisager en lien avec l’Europe et ses urgences actuelles. Il s’agira de mettre en lumière les résonances entre leurs demandes et les revendications contemporaines (climat, racisme, féminicides, montée des extrêmes droites), en analysant le rôle de l’image et de la performativité. L’objectif est de chercher comment les images façonnent et révèlent la construction visuelle du social (Mitchell 2014), et de comprendre comment les pratiques performatives liées à ces luttes participent à construction des imaginaires sociaux de l’Europe contemporaine.
Résolument interdisciplinaire, Ce colloque se situe à l’intersection de plusieurs champs : histoire globale, histoire culturelle, histoire de l’art, études de genre, histoire des luttes, études visuelles, géographie et études décoloniales. En plaçant l’image et son rapport aux luttes pour l’émancipation au centre de l’analyse, il invite à une lecture transnationale d’histoires partagées depuis les marges géographiques et sociales.
Axes thématiques proposés :
- Gestes, images et culture matérielle de et dans la protestation/résistance : réseaux et circulations transnationales du Chiapas (Mexique) à l’Europe (et inversement).
- Lieux de rencontres, collaborations et zones de contact entre pratiques esthétiques/politiques du Sud global et les mouvements sociaux européens.
- Stratégies esthétiques partagées entre mouvements sociaux européens et pratiques du Sud global : continuités et transformations du zapatisme et de la Travesía por la vida.
- Continuités et ruptures esthétiques et politiques entre le cycle altermondialiste et l’époque contemporaine.
- Cooptations esthétiques des stratégies militantes par l’extrême-droite.
- Représentations de l’altermondialisme dans une perspective de genre ; relectures féministes et LGTBIQ+ des luttes.
- Redécouverte d’acteurs et de figures marginalisé·e·s du cycle antimondialisation.
- Nouvelles reconfigurations de la représentations de la nature, de la Terre et de l’humain
- Nouveaux portraits de la militance écologiste
- Études sur les différentes constructions du sujet collectif militant.
- (Re)écritures historiographiques du mouvement de résistance à la mondialisation à travers expositions et projets artistiques.
Modalités de soumission
Le colloque aura lieu les 22, 23 et 24 avril 2026 à l’Université Grenoble Alpes.
Les langues officielles seront le français, l’espagnol et l’anglais.
Les propositions (résumé de 300 mots) seront envoyées, accompagnées d’une courte biographie, avant le 7 décembre 2025 aux mails anita.orzes@univ-tlse2.fr et info@modernidadesdescentralizadas.com en indiquant dans l’objet : « Colloque Réverbérations altermondialistes et zapatistes (RAZ)».
Direction : Paula Barreiro López (Université Toulouse II Jean Jaurès – Institut Universitaire de France), Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes), Julia Ramírez-Blanco (Universidad Complutense de Madrid)
Coordination : Anita Orzes (Université Toulouse II Jean Jaurès) et Cristina García Martínez (Université Grenoble Alpes)
Comité scientifique : Paula Barreiro López (Université Toulouse II Jean Jaurès – Institut Universitaire de France), Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes), Tobias Locker (Saint Louis University, Madrid), Anita Orzes (Université Toulouse II Jean Jaurès), Julia Ramírez-Blanco (Universidad Complutense de Madrid), María Ruido (Universitat de Barcelona), Fabiola Martínez Rodríguez (Saint Louis University Madrid).
Colloque organisé dans le cadre des projets Esthétiques tricontinentales et leurs échos dans l’Europe du Sud (Institut Universitaire de France) ; Images politiques et nouveaux mondes à construire : la culture visuelle du voyage des zapatistes pour la vie en Europe / NOVA-IMAGO-ZAP (Labex SMS de l’Université Toulouse Jean Jaurès), avec le soutien d’ILCEA4 de l’Université Grenoble Alpes et de la plateforme internationale de recherche Modernité(s) Décentralisée(s).
Bibliographie
Agrikoliansky, Eric, Olivier Fillieule et Nonna Mayer. (2005). L’altermondialisme en France : la longue histoire d’une nouvelle cause. Paris : Flammarion.
Baronnet, Bruno, et al. (2011). Luchas muy otras: Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. México : Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Xochimilco.
Baschet, Jérôme. (2002). L’étincelle zapatiste, insurrection indienne et résistance planétaire. Paris : Denoël.
Baschet, Jérôme. (2022). La rébellion zapatiste et l’internationalisme du XXIe siècle : luttes planétaires et pluralité des mondes. Cause commune, Dossier n°29.
Duterme, Bruno. (2021). « EZLN en Europe : entre enthousiasme et marginalisation ». Le Regard du CETRI, 17 juin. Disponible en : https://www.cetri.be/L-EZLN-en-Europe-entre
Enlace Zapatista. (2021). « Declaración por la vida », 21 janvier 2021. Disponible en : https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/
Hardt, Michael, et Antonio Negri. (2004). Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire. Paris : La Découverte.
Fioravanti, Carlos (2022). La Cumbre de la Tierra Rio 92 consolidó conceptos sobre el medio ambiente. Pesquisa FAPESP, mai, Edición 315, https://revistapesquisa.fapesp.br/es/la-cumbre-de-la-tierra-rio-92-consolido-conceptos-sobre-el-medio-ambiente/
Land, Nick. (2019). La Ilustración oscura (y otros ensayos sobre la Neorreacción). Materia Oscura Editorial.
Luttwak, Edward N. (2000). Turbocapitalismo: Quienes ganan y quienes pierden en la globalización. Barcelona : Crítica.
Milani, Carlos R. S. et Keraghel Chloé (2007) , « Développement durable, contestation et légitimité : la perspective des mouvements altermondialistes », Cahiers des Amériques latines, 54-55 | 2007, 137-151.
Mitchell, W.J.T. (2014). Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle. Paris : Les Presses du Réel.
Oropeza Álvarez, Daliri. (2019). « Sensibilidad zapatista: ¿Arte para qué y para quién? ». Pie de Página, 10 décembre. Disponible en : https://piedepagina.mx/sensibilidad-zapatista-arte-para-que-y-para-quien/
Plihon, Dominique. (2019). « Où en est le mouvement altermondialiste ? ». Cités, 2019/4, N° 80, pp. 101-108. Disponible en : https://shs.cairn.info/revue-cites-2019-4-page-101.htm?lang=fr.
Sergi, Vittorio, (2006). Visiones intergalácticas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Bajo el Volcán, 6(10), 149-159. Disponible en : https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28661016
Zagato, Alessandro, et Natalia Arcos. (2017). « El Festival “Comparte por la Humanidad”. Estéticas y poéticas de la rebeldía en el movimiento Zapatista ». Páginas, año 9 – n° 21, Septiembre-Diciembre, pp. 74-101. Disponible en : http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas