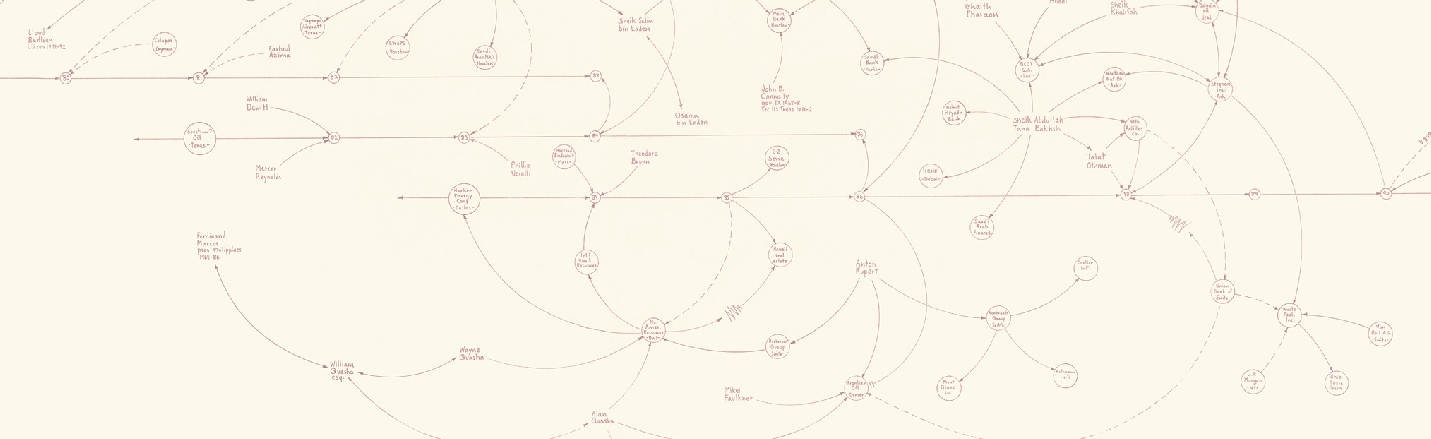De la Biennale au bienales. Le désir impossible
26 – 28 avril 2023
Aula magna “Silvio Trentin”, Ca’ Dolfin, Université Ca’ Foscari Venise et en linge
En 2000, René Block déclare que « le terme « Biennale » n’est pas protégé par le droit d’auteur et est donc ouvert aux abus » (Glaser, 2000). L’année suivante, la Revista USP a publié un article d’Ivo Mesquita, qui commençait par une longue liste de biennales, nous faisant voyager à travers les cinq continents (Mesquita, 2001/2002). Et « Bienais, bienais, bienais… » est aussi le titre de la table ronde qui, à l’occasion de Em vivo contato (28e Biennale de São Paulo, 2008), a tenté d’élaborer des catégories et des typologies de biennales et de définir leurs différents objectifs, en s’ajoutant aux tentatives précédentes ou en cours (Enwezor, 2003/2004 ; Bydler, 2004 ; Van Hal, 2010).
En fait, les biennales sont un véritable casse-tête. Elles le sont autant par leur caractère hétérogène et leur format d’exposition changeant que par des intérêts ou des ambitions locales ou globales à la fois culturelles et géopolitiques (Enwezor, 2003/2004 ; Gardner / Green, 2016 ; Hanru, 2005). Mais les biennales sont aussi un désir impossible. Elles le sont du fait que » le modèle lui-même (…) découle du désir impossible de concentrer en un seul lieu les mondes infinis de l’art contemporain » (Gioni, 2013), du fait de leur nombre même, désormais incalculable, et du fait d’un phénomène incommensurable dans sa complexité.
Dans une perspective à la fois globale et locale, l’objectif est ici de proposer une interprétation du phénomène des biennales entre les années 1930 et 1980. Un arc chronologique qui part du moment où, sous le régime fasciste, l’Exposition Internationale d’Art de Venise change de nom, devenant officiellement la « Biennale », et se termine par la décennie qui a vu, d’une part, l’institution de la première Biennale d’architecture de Venise (1980) et, d’autre part, la contraction de la carte biennale avec la fondation de la Biennale de La Havane et sa troisième édition (1984 et 1989).
Au cours de ces cinquante années, le modèle biennal a commencé à se répandre non seulement dans la région méditerranéenne (Biennale d’Alexandrie, 1955 ; Biennale du Caire, 1984), dans la région atlantique (Biennale de São Paulo, 1951 ; Biennale interaméricaine de Mexico, 1958 ; Biennale des jeunes de Paris, 1959) et dans le Pacifique (Biennale de Tokyo, 1952 ; Biennale de Saigon, 1962 ; Biennale de Sydney, 1973) ; mais aussi dans la péninsule italienne elle-même (Biennale di Arte Antica ; Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea, 1955 ; Biennale de Cittadella, 1966 ; Biennale de Lignano, 1968 ; Biennale de Gubbio, 1973). Chacune de ces biennales possède donc non seulement un format d’exposition spécifique, mais aussi une généalogie particulière, marquée par des intérêts plus ou moins locaux et un contexte historique, culturel et politique précis, qui méritent d’être analysés et mis en dialogue les uns avec les autres.
Ce colloque vise donc à créer un espace de réflexion et de dialogue sur le terme « Biennale », le phénomène des biennales et les histoires individuelles et collectives des biennales qui ont vu le jour entre les années 1930 et 1980.
Le congrès se déroulera en présentiel et par zoom.Pour assister à la conférence par zoom, veuillez vous inscrire ici.
Programme Affiche Gallery10.00 – 10.30 Salutations institutionnelles
Caterina Carpinato (Prorettrice della Terza Missione, Università Ca Foscari Venezia)
Giovanni Vian (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia)
Deborah Rossi (Responsabile Organizzativo ASAC | Fondazione La Biennale di Venezia)
10.30 – 11.00 Introduction
Stefania Portinari (Università Ca’ Foscari Venezia)
Anita Orzes (Universidad de Barcelona / Université Grenoble Alpes)
Vittorio Pajusco (Università Ca’ Foscari Venezia)
11.00 – 13.00 Panel 1 – biennials, biennials, biennials…
Modération: Stefania Portinari (Università Ca’ Foscari Venezia)
Nuria Querol (Goldsmiths, University of London), Southern Biennales in India: Paradoxes and Impossible Desires in Global Art and Politics
Kristian Handberg (University of Copenhagen), The Socialist Biennial between Art and Politics: The case of Danish artists at biennials in the GDR, 1965-1989
Irene Quarantini (Sapienza Università di Roma), Appeal for a possible alternative: micro-history of the Arab Biennale 1974 – 1976
Nathalie Zonnenberg (Open Universiteit), The Biennale model: Key to Success or Recipe for Disaster? The Sonsbeek 20-24 Affair
13.00 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Panel 2 – Brazil and the Biennial ‘Condition’
Modération: Vinicius Spricigo (Universidade Federal de São Paulo)
Tatiane de Oliveira Elias (Universidade Federal de Santa Maria), As Bienais brasileiras e a geopolítica
Dária Jaremtchuk (Universidade de São Paulo), The Museum of Modern Art of New York at the São Paulo Biennials: 1951-1961
16.00 – 16.15 Pause
16.15 – 17.45 Panel 3 – Biennials of Engraving
Modération: Stefania Portinari (Università Ca’ Foscari Venezia)
Mariagrazia Muscatello (Universidad de Chile / Università Ca’ Foscari Venezia), Le biennali cilene nel contesto latinoamericano dal 1963 al 1990
Wiktor Komorowski (The Courtauld Institute of Art), The Inrush and Regress of Modernity: The Demise of Krakow’s International Biennale of Graphic Arts
Alessia del Bianco (Accademia di Belle Arti Venezia), Le Biennali di Incisione Italiana Contemporanea all’Opera Bevilacqua La Masa, 1955-1968
10.00 – 11.30 Panel 4 – The Geopolitics of Biennials
Modération: Stefania De Vincentis (Università Ca’ Foscari Venezia)
German Alfonso Nunez (University of the Arts London), The biennale as a bureau de change: symbolic exchange, the Cultural Cold War, and the case of the planned US exhibition in the X São Paulo Biennale
Ana Eres (University of Belgrade), The Shifting Policies of Representing Conceptual Art from Yugoslavia at Biennials in the 1970s: An Overview
Luca Palermo (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), A Sud dell’impero. Le “altre” Biennali tra anticolonialismo e postcolonialismo (1951-1987)
11.30 – 12.00 Pause
12.00 – 13.00 Panel 5 – Assembling and Disassembling: National Pavilions
Modération: Anita Orzes (Universidad de Barcelona / Université Grenoble Alpes)
Laura Moure Cecchini (Università degli studi di Padova), Between Discrimination and Self-Exclusion: Latin America at the Venice Biennale in the First Decade of the Fascist Regime
Marina Martin Barbosa (Independent Researcher / Photo Elysée Lausanne), Brazil in the « renewed international solidarity » of biennials
13.00 – 15.00 Pause
15.00 – 16.15 Here and There: Exchanges between Italy and Brazil from the Biennials (1948-1952)
Conversation: Vinicius Spricigo (Universidade Federal de São Paulo) et Ana Magalhães (Museu de Arte Contemporânea – Universidade de São Paulo)
Modération: Anita Orzes (Universidad de Barcelona / Université Grenoble Alpes)
16.30 – 18.00 Panel 6 – São Paulo Biennial: Multidirectioan Wefts
Modération: Vittorio Pajusco (Università Ca’ Foscari Venezia)
Maria de Fátima Morethy Couto (Universidade Estadual de Campinas), The Pan-American Union and the São Paulo Biennial (1955-1967): geopolitical arrangements in defense of modern art
Tálisson Melo de Souza / Marina Mazze Cerchiaro (Universidade de São Paulo), The international awards at the Bienal de São Paulo (1951-1979): circulation, prestige and symbolical cartographies of art
Gabriela Saenger Silva (Liverpool John Moores University), Archaeology of Engagement and Discursive practices in biennials: São Paulo Biennial
Sileno Salvagnini (Accademia di Belle Arti Venezia) Focus on the exchanges between Italian Artists and São Paulo Biennial from several Italian Archives
10.00 – 12.00 Panel 7 – Biennials as Interfaces of Dimensions
Modération: Marianna Rossi (Università Ca’ Foscari Venezia)
Giulia Pollicita (University of the Arts London), Locating Representations: Biennials as Vectors of National, International, and Transnational Art Ecosystems
Francisca Gigante Godinho da Silva (Universidade Nova de Lisboa), Tensions between the national and international dimension at the Venice Biennale and documenta in Kassel in postwar Europe: the 1980s
Francesca Della Ventura (University of Cologne/ Università degli Studi del Molise), The Future of the Biennales: Curating Art Collectives between Global Art and Contestation
Yannick Le Pape (Musée d’Orsay), The flags and the flow. A critical story of the Biennale di Venezia, from local gardens to global village
12.00 – 12.30 Conclusions
Gallery







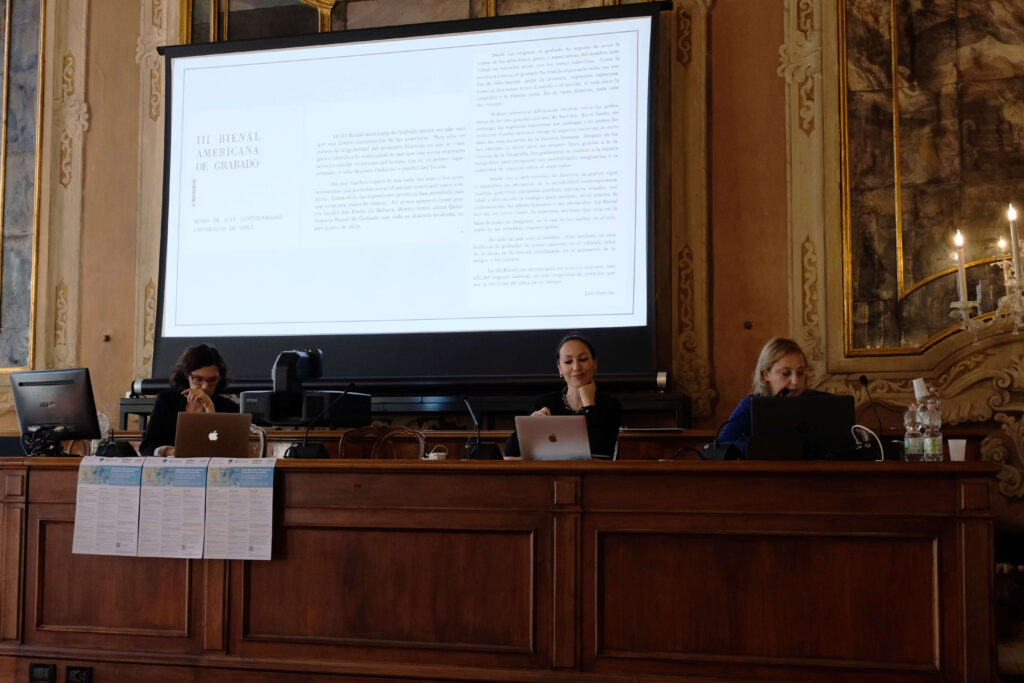

Organisation du coloque
Anita Orzes (Universidad de Barcelona / Université Grenoble Alpes)
Vittorio Pajusco (Università Ca’ Foscari Venezia)
Stefania Portinari (Università Ca’ Foscari Venezia)
Comité scientifique
Olga Fernández López (Universidad Autónoma de Madrid)
Ana Magalhães (Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo)
Anita Orzes (Universidad de Barcelona / Université Grenoble Alpes)
Vittorio Pajusco (Università Ca’ Foscari Venezia)
Stefania Portinari (Università Ca’ Foscari Venezia)
Vinicius Spricigo (Universidade Federal de São Paulo)
Le coloque est organisée par le Dipartimento di Studi Umanistici de l’Università Ca’ Foscari Venezia, le Departamento de Historia del Arte de l’Universidad de Barcelona, la plataforme internacionale Modernidad(es) Descentralizada(s) et le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) de l’ Université Grenoble Alpes.